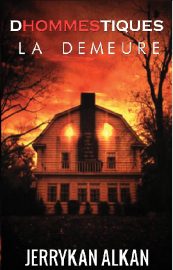28 Décembre 2012, 18 ans
Je tâtonne ici et là à la recherche de sa main. Elle qui englobait mes petits doigts à l’époque pour me dire ne t’en fais pas je suis là. Il y a treize ans déjà. Mais à la place, je ne trouve que mon vieil oreiller craqué.
Chacune de mes insufflations flotte sur le drap comme le souffle du vent sur la cime des arbres. Emmitouflé sous la couette comme une mouche dans le cocon blanc d’une araignée, j’essaye de limiter les tremblements de mes membres.
J’ai peur.
Machinalement, je change de position et me couche sur l’autre flanc. Les méchantes lattes en profitent pour grincer et je m’immobilise alors immédiatement.
La nuit, il vaut mieux rester silencieux. C’est le seul et long moment de la journée où les Autres s’arrêtent. Pour dormir j’imagine. Ils peuvent ainsi entendre le moindre de nos faits et gestes. Alors, mieux vaut ne pas les prévenir qu’ils en ont oublié deux.
Que nous sommes encore là. Dans notre maison de toujours. Dans notre cher petit village.
J’entends à peine Arthur ronfler, à l’autre bout de ma chambre, dans un lit que j’ai aménagé comme j’ai pu, obscurité oblige. Décidément, je me demande bien comment il arrive à trouver le sommeil. Avec tout ce qui se passe à l’extérieur.
J’ai l’impression qu’il a gagné en maturité ces derniers temps, depuis que les événements ont commencé. Mais en même temps, je vois bien qu’il est mal dans sa peau. Lui qui adorait marcher de longues heures dehors, arpenter les rues et respirer l’odeur de la ville. Ça l’apaisait. C’était vital pour lui. Bien plus que tous les médicaments que les médecins lui prescrivaient pour canaliser sa maladie.
Enfin, tout cela appartient au passé. Il ne prendra probablement plus jamais de cachets. Il ne reverra peut-être jamais la lumière du jour. Moi non plus d’ailleurs. Qu’importe, je suis fier de lui aujourd’hui. J’imagine qu’il doit faire des efforts incommensurables pour rester discret dans la maison en permanence, lui qui piquait si souvent des crises de nerf. Et puis la disparition de nos parents doit sans aucun doute le torturer autant que moi. Je me demande combien de temps il va tenir comme ça.
Combien de temps allons-nous tenir retranchés dans notre maison, avant que les Autres ne s’aperçoivent que nous vivons à l’intérieur ?
A travers le fin tissu aux motifs bleu encre de mon drap, j’aperçois une raie de lumière à coté de mon volet en bois. Le jour se lève. Je n’ai pas dormi de la nuit.
Les sachant certainement repartis à leurs occupations, je sais que nous ne risquons plus grand chose maintenant, c’est pourquoi je décide de me lever pour aller manger. En remuant mes jambes, mon genou cogne dans quelque chose de dur et métallique. Je me rappelle alors que j’ai un fusil avec moi au lit. Celui que conservait mon père précieusement dans la cave. Je me redresse une bonne fois pour toute et frotte mes yeux décomposés.
Je manque de sursauter quand Arthur m’interpelle par un chuchotement :
« Tu es réveillé ?
-Ouais. Je pensais que tu dormais. »
Arthur ne me répond pas tout de suite. Il jette un rapide coup d’œil en direction des volets, un regard vide, puis répond :
« N’entend pas… dehors n’entend pas les oiseaux. »
Je tend l’oreille un instant, et aussitôt je m’en veux de ne pas y avoir prêter attention plus tôt. Après une semaine enfermé ici, j’aurais dû le remarquer.
« Non. On ne les entend pas.
-Les… ça chante plus les oiseaux ? M’interroge Arthur en me dévisageant de son visage d’enfant, les cheveux châtains coupés court, les yeux vert perçant. »
Sans pouvoir l’expliquer, mes mains se mettent à trembler, et j’essaye de masquer le nœud qui se noue dans ma gorge, en vain. Mes yeux couleur noisette qu’arborent de profonds cernes de fatigue viennent se rattacher à ceux de mon frère, et je serre la mâchoire avant de déclarer :
« Non. Les oiseaux ne chantent plus. Et je crois bien qu’ils ne chanteront plus jamais. »
447
 Tellyon
Tellyon